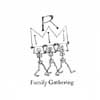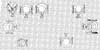- Accueil
- > Shakespeare en devenir
- > N°2 — 2008
- > Family Gathering ou La Danse Macabre de RIII
Family Gathering ou La Danse Macabre de RIII
Par Édouard Lekston
Publication en ligne le 26 juillet 2010
Table des matières
Texte intégral
I. Genèse et composition de l’œuvre
La structure en triptyque
1Mon idée première a été de faire un seul recueil avec des illustrations de scènes précises au fil desquelles la danse macabre se déroulerait en filigrane. Puis, la danse macabre s’est imposée pour devenir une œuvre à part entière. Enfin, j’ai fini par y ajouter la carte d’Angleterre qui me semblait un complément indispensable.
2Mon travail achevé sur Richard III se compose donc de trois volets :
-
Le recueil de dessins pour chaque scène. Les actes, quant à eux, s’ouvrent tous sur le portrait de Richard III qui se métamorphose en lycanthrope, ou plutôt en homme-sanglier, au fur et à mesure que l’on avance dans la pièce.
-
La danse macabre de Dickon – c’est le surnom qui est donné à Richard dans Henry VI – qui se présente sous la forme d’une frise à déployer. Le maître-danseur en est Richard III lui-même ; c’est lui qui donne la cadence de cette danse macabre dans laquelle il entraîne toute sa famille, toute la maison d’York, y compris lui-même finalement. Cette frise me semble assez claire, elle se suffit à elle-même : les unes après les autres, toutes les victimes de Richard se retrouvent contraintes de participer à cette danse. Et quand la danse macabre enfin s’achève, la vie et la nature reprennent le dessus – les lances de guerre se transforment en arbres.
-
Une grande carte d’Angleterre, de type antique, en forme de cheval, carte dessinée comme un puzzle, marquée par les batailles de la guerre des deux roses.
3Une fois ces trois volets réalisés, le souhait m’est venu de les présenter sous forme d’un coffret.
Les références en filigrane
4Avant d’envisager RichardIIIcomme une danse macabre, j’avais pensé à représenter la pièce sous forme d’un grand jeu de chaises musicales – d’où l’idée de la table du dîner de famille avec un nombre de couverts qui s’amenuise au fil de la tragédie. Ces deux visions de la pièce, danse macabre et banquet familial, sont évidemment à mettre en regard. En dessinant cette grande table familiale, j’ai pensé au film de Thomas Vinterberg, Festen (1998), où des paroles très dures s’échangent lors de la réunion – d’ailleurs, le titre de Family Gathering est, en partie, inspiré de Festen.
5J’ai aussi eu à l’esprit le RichardIII(1995) de Richard Loncraine, transposé dans les années 1930, avec Ian McKellen dans le rôle titre. Ce film est, à mon sens, une adaptation intelligente de la pièce de Shakespeare dans le monde fasciste des années 30, une adaptation qui respecte l’humour du texte et joue avec lui. Je me suis inspiré du ton du film en général et, en particulier, du visage de l’acteur Jim Broadbent pour dessiner la tête de Buckingham. Ces deux films m’ont accompagné dans mon travail.
6J’ai aussi été influencé par le climat politique de la France à une période donnée. Je n’ai pas pu m’empêcher d’entendre des échos subtils entre Richard III et l’actuel Président français. Dans une certaine mesure, la campagne présidentielle a été le déclencheur de ce travail: j’y ai vu, comme dans RichardIII, une immense mascarade «médiatico-politique», quelque peu grossière de surcroît.
7Dans une moindre mesure, j’ai aussi pensé à l’opéra que György Ligeti a composé en 1978, avec des décors de Roland Topor: Le Grand Macabre. C’est un opéra truculent, rabelaisien, qui renvoie au monde fourmillant de Bruegel où les valeurs se renversent. Dans cet opéra, un mystérieux individu se fait passer pour la Mort, à moins qu’il ne soit vraiment la Mort… À la fin, ce sont les humains qui l’emportent sur la Mort. Ce qui m’a intéressé dans cet opéra, et que j’ai repris dans Family Gathering, c’est le fait que le banquet et le macabre se côtoient.
Le traitement en noir et blanc
8Pourquoi un traitement en noir et blanc, contrastant franchement avec la couleur utilisée dans mes travaux précédents? Il y a d’abord, inutile de le nier, une réponse purement financière. Le premier exemplaire du coffret sera assez brut, constitué de photocopies en noir et blanc. Brut pour l’aspect financier, mais aussi pour l’aspect radical.
9Ensuite, je dirais que RichardIIIest une œuvre qui s’est imposée à moi en noir et blanc. J’ai voulu retrouver le dessin pur, sans couleur, la force du dessin de presse, le trait mordant des journaux imprimés. On pourrait, ici, faire un rapprochement avec le style du Canard Enchaîné: mon RichardIII, rebaptisé Family Gathering, est comme un journal imprimé noir sur blanc, à tendance satirique, qui fonctionnerait comme un condensé, qui offrirait au lecteur un miroir, un défilement de la vie du pays, de ses nouvelles les plus marquantes, les plus tranchantes. Cette radicalité du noir sur blanc, c’est aussi une façon de montrer la violence et la brutalité de la mise en scène politique. C’est seulement à la fin de la danse macabre qu’un peu de couleur surgira: la couronne royale aura quelques touches colorées, et Henry Tudor sera en rouge, symbole du retour à la vie.
Extraits du carnet de notes
Notes d’introduction (non datées)
10Les notes de mon carnet de préparation commencent avec, en exergue, les premiers vers de la pièce: «Now is the winter of our discontent / Made glorious summer by this son of York» / «Voici donc que l’hiver de notre déplaisir / Se fait été de gloire avec ce soleil d’York1».
11Dans ma vie intime, et donc artistique, c’est comme si j’avais suivi la logique d’une suite numérique: après RichardII, RichardIIIs’était imposé à moi comme une évidence. Après l’abandon de soi, le chagrin et le désarroi, j’ai été en proie à la rage, à la colère, à l’envie de crimes. Alors comment laver cette rancœur, ces frustrations et cette noirceursinon en dessinant RichardIII. Cet «exorcisme» était, pour moi, un grand défi.
12Richard III prend possession de tout, des corps comme des cœurs, et il les met au même niveau que les objets. Pas d’amour chez Richard III contrairement à Richard II à qui il ne reste que le pouvoir d’aimer. Richard III, lui, porte, si l’on peut dire, cette amputation d’amourdès la naissance; son corps est en quelque sorte une allégorie de l’anti-amour, autrement dit de la haine. En lisant la pièce, je m’aperçois que le corps de Richard est comme en mutation, qu’il prend diverses formes pour mieux assouvir sa soif de pouvoir. Tour à tour, dans mes dessins, Richard III devient un cercueil, celui d’Henry VI, un sanglier, un crapaud, la table de négociations pour le couronnement du prince, la Tour de Londres, une couronne, un cheval, un champ de bataille, une épée. Comme le diable, il sait prendre toutes les formes.
Notes du 7 juillet 2007 : Le noir et le blanc radical
13Comme pourles innombrables tracts d’une quelconque propagande fasciste, le recueil sera photocopié à moindres frais. Par cette radicalisation, par cette condition plastique que je m’impose, je renoue avec le dessin pur, au carbone. Je peux y ajouter tout de même une touche de rouge, pour Richmond, ou de jaune pour la couronne. Pour certains exemplaires, un papier à dessin sera choisi mais ce sera une sorte de papier journal, «gris et sale», qui prédominera sur l’impression. La photocopie viendra comme une répétition infernale, suggérant qu’il y aura d’autres Richard III, d’autres hommes avides de pouvoir et de sang.
Notes du 8 juillet 2007
14[Après avoir vu une émission Théma sur la mafia sicilienne]
15Dans les règlements de compte de la mafia sicilienne, lorsque l’on exécute quelqu’un, on exécute aussi les membres de la famille, y compris les enfants pour éviter les vengeances.
Notes du 19 juillet 2007
16Comme dans les enluminures et les miniatures médiévales, j’utilise avec une certaine ironie les échelles tronquées des corps des personnages selon leur importance hiérarchique; je reprends l’idée de la perspective d’importance. Ainsi, Richard III est souvent grand, très grand, et parfois monstrueux. Par exemple, sa main seule peut suggérer qu’il est bien plus grand que la Tour de Londres.
Notes du 22 juillet 2007
17Je suis de moins en moins persuadé du pouvoir d’exorcisme de ce travail graphique sur Richard III. Je pense même, au contraire, que sa noirceur et son aigreur m’atteignent. Quelque chose, voire de multiples petites choses, m’empêchent de continuer.
Notes du 15 septembre 2007
18«Quand on traite du mal, quand on se met dans la peau de quelqu’un qui est atteint par le mal absolu, alors la pudeur n’existe plus». C’est une citation de Maurice G. Dantec dansl’émission F.O.G (France 5), en parlant du travail d’écriture de son livre Artefact.
Notes non datées
19Cette semaine je reprends expressément le travail sur Richard III après plus d’un mois d’arrêt. Dans Richard III, tout ce que je sais, c’est qu’il est question de pouvoir. Le pouvoir à l’état pur, transcendant l’humain, puis le terrassant.
II. Dessins et gloses
20En préambule
21La couronne reposant sur les soies du sanglier.
22La guerre des deux roses personnifiée qui accouche du monstre, du futur dictateur Gloucester.
23Plan de table 1.
24Plan de table d’une réunion de famille avec quelques protagonistes de l’acte qui va suivre. Chacun est positionné selon son importance et le degré de connivence qu’il a avec son voisin. Margaret, dite Maggie, qui a été bannie, a une écuelle en bois. La nappe, c’est un motif de roses blanches pour la maison d’York.
25Acte I
26Scène 1.
27Richard fait son discours au soleil qui est, en fait, le portrait de son frère Edouard qui le regarde en souriant.
28Scène 2.
29Lady Ann est prostrée contre le corps d’Henry VI et dans le cœur de ce corps se cache, tel un crapaud, le petit corps de Richard III qui va prendre possession du cœur de Lady Ann.
30Scène 3.
31C’est une carte d’Angleterre renversée. Les paires de ciseaux courent après Margaret. Elle dit à Richard: «Je viens pour répéter tes dettes, tes forfaits», et énumère ce qu’il lui doit. La maison d’York est représentée par métonymie: la lettre Y est devenu une paire de ciseaux qui découpent le corps royal de Margaret, et qui découpent jusqu’à l’Angleterre elle-même. Elle redit ce qui s’est passé dans Henry VI.
32Scène 4.
33C’est le cauchemar de Clarence. On voit Clarence en train de se noyer dans un aquarium dont il est prisonnier. Et apparaît au fond de l’aquarium, parmi des multiples bijoux, le squelette du prince Edward. Les deux meurtriers s’avancent vers l’aquarium comme des chats prêts à attraper un poisson.
34Ce dessin rappelle les dictons du fou que j’avais illustrés dans mon précédent travail sur Le Roi Lear. J’ai représenté la conscience du meurtrier en proie aux remords. Chaque phrase qui traduit ce que lui dit sa conscience est représentée par un fou. Je me suis très largement inspiré des dessins de Dürer dans La nef des fousde Sébastien Brant.
35Clarence demande à l’un des meurtriers: «Au nom de Dieu, qui es-tu?» Et la réponse est: «Un homme comme vous». Il s’agit ici d’une variation sur une planche d’anatomie, avec la définition de l’homme. On y voit les deux assassins, le cadavre de Clarence et ce cadavre devenu squelette dans le cercueil.C’est une évocation récurrente chez Shakespeare – on la trouve aussi dans Macbeth. En regard se trouve une planche anatomique du cerveau, pour rappeler que le cerveau du meurtre, c’est Richard. Cela va laver la culpabilité des meurtriers qui ne sont que des commanditaires. En bas à droite, la main de la pensée, de la conscience, est en déroute.
36Acte II
37Variation sur le plan de table.
38À la place du plan de table, j’ai représenté une réunion de famille organisée par le Roi et la Reine pour faire la paix. Tout le monde s’y rend de bon cœur, sauf Richard qui sait que Clarence est déjà mort. C’est cette nouvelle qui va réveiller la zizanie. La chaussure du mercure vient percuter la colombe de paix.
39Scène 1.
40Schéma du mercure ailé qui va plus vite que l’éclopé.
41Scène 2.
42Je reprends le propos de la duchesse qui dit: «Ah! Quels contours flatteurs sait prendre le mensonge, / Sous masque de vertu cachant vice profond! / C’est mon fils, il est vrai, et par là c’est ma honte. / Ce n’est pas dans mon lait qu’il a puisé sa ruse». J’ai aussi repris l’emblème de la couronne d’Angleterre, et j’ai transformé le lion rampant de l’héraldique en une sorte de monstre qui dévore tout ce qu’il trouve. Ce lion-lionne a des mamelles, rappelant clairement le schéma d’une couronne, mamelles que tète le petit Richard de Gloucester.
43Scène 3.
44C’est un petit garçon qui porte une couronne bien trop grande pour lui. Elle lui recouvre les yeux. Cela renvoie à la discussion qu’ont les trois citoyens, très inquiets pour l’avenir de leur pays. Ces trois citoyens se retrouvent dans une embarcation figurée par un petit bateau en papier fait à partir d’une carte de l’Angleterre. Le petit garçon pousse l’embarcation à l’eau et, sur la page suivante, on peut voir qu’elle va être avalée par une vague immense.
45Scène 4.
46C’est la scène avec Elizabeth et ses jeunes enfants. York dit: «Grand-mère, un certain soir qu’on était à souper, / Oncle Rivers disait que je poussais plus vite que mon frère». Les fleurs ont été dessinées par le neveu et la nièce de ma compagne. Je me suis inspiré de la perspective de la peinture flamande en reprenant la fenêtre d’où l’on peut voir des bouts de jardins.
47Lord Rivers et Grey sont envoyés à Pomfret. Elizabeth s’écrie: «Malheur à moi! Je vois notre maison en ruine. / Le tigre s’est jeté sur la biche timide».
48Acte III
49Plan de table 2.
50Le Roi a disparu. La toute petite assiette est celle de l’enfant. Richard est à côté des enfants pour montrer qu’il en est le tuteur.
51Les cartes de tarot.
52Deux cartes de tarot font référence au troisième acte: l’arcane du Diable et l’arcanede la Maison Dieu. La première page montre Richard III en diable tenant, à l’aide d’une corde, les deux enfants. Sur la page suivante, on voit une main qui secoue la couronne d’où tombent les deux enfants qui atterrissent dans une tour, la Tour de Londres, symbolisée par la Maison Dieu.
53Scène 2.
54J’aime beaucoup la scène 2 du troisième acte; je la trouve très amusante. J’ai dû faire plusieurs esquisses avant de trouver la forme de Richard III, cette sorte de gros monstre tout poilu, mi-homme, mi-sanglier. Cette scène, c’est le cauchemar de Stanley. À l’origine, j’avais dessiné Stanley, en robe de chambre et en bonnet de nuit, avançant dans la brume vers Hastings qui caressait cette grosse bête poilue qu’est Richard III. Puis, à force de le travailler, ce dessin s’est modifié: Stanley est maintenant alité avec une grosse fourrure en guise de couverture; Hasting le borde. Or, au niveau de la descente de lit, la fourrure dévoile un sanglier…
55Scène 3.
56Rivers, Grey et Vaughan en route vers la prison de Pomfret où ils vont mourir. J’ai représenté le fantôme ou la pensée lugubre de la Reine Margaret qui les maudit. Margaret est à la fois une folle, une sorcière et un fantôme. Elle n’a plus de pieds; elle flotte tel un fantôme déchu. Je me suis inspiré de la vague des nouveaux films fantastiques japonais dans lesquels les petites filles aux cheveux noirs et aux yeux cachés sont un signe de mauvais augure.
57Pomfret, c’est un bâtiment qui ressemble à la fois à une bouche d’égout et à un château, avec l’inscription «Pomfret – Gutter», c’est-à-dire les égouts de Pomfret. J’ai travaillé à partir de frottis de vraies bouches d’égout.
58Dans le ciel volent des roses blanches, symboles de la maison d’York. Ces roses, au gré du vent, perdent leurs épines, et ces épines viennent se planter dans le front des trois malheureux, faisant couler leur sang qui va ruisseler jusque dans l’égout de Pomfret.
59Scène 4.
60C’est la table de négociations où va se décider la date de couronnement du prince. Il s’agit d’une scène intéressante qui m’a permis de représenter un Richard III en pleine mutation graphique, un Richard III qui fait littéralement corps avec la table de négociations et qui prend possession des individus qui s’y trouvent. C’est aussi dans cette scène qu’il mentionne son bras ensorcelé, qu’il en rend Hastings responsable et qu’il exige la tête de ce dernier. J’ai imaginé le bras de Richard III comme une branche immense, comme une liane, qui va se saisir de la tête de Hastings et l’arracher, au grand étonnement des autres excepté de Buckingham qui sourit sournoisement, car il est de mèche avec Richard III.
61Scène 5.
62Richard et Buckingham expliquent au maire, à grand renfort de mensonges, que Hastings était un traître et qu’il fallait donc le décapiter. Ce que je trouvais amusant dans cette scène, c’est qu’ils sont en armure comme s’ils revenaient d’un combat contre un putschet qu’ils ont monté toute une mise en scène pour le maire. J’ai joué avec l’idée d’un épouvantail revêtu d’une armure et dont la tête est celle de Hastings, sorte d’épouvantail tenu par Catesby qui va devenir l’exécutant du futur Richard III à l’instar de Buckingham. J’ai représenté Catesby comme un chat à cause de son nom: j’en ai fait un homme-chat, malin, futé, et aussi très silencieux. Ce qu’il y a d’intéressant aussi dans cette image, c’est que le sens du spectacle est inversé: on se trouve du côté du marionnettiste (Catesby), de l’autre côté du rideau / de la muraille.
63Scène 6.
64On retrouve Catesby qui apporte le rapport au greffier. Ce dernier est très surpris par l’exécution rapide de Hastings. J’ai représenté cette scène par le jeu du pendu. Le greffier a du mal à trouver le nom de Hastings.
65Scène 7.
66C’est la scène qui m’amuse le plus, tant dans la pièce que dans le dessin que j’en ai fait. J’ai vraiment forcé le ton. Dans cette scène, Richard, sur les conseils de Buckingham, décide de jouer à un jeu, celui de l’homme pieux qui, par abnégation, refuse la couronne, prétendant qu’elle est beaucoup trop lourde à porter. Tout en disant cela, il tient à la main une bible et feint de sortir d’un grand moment de méditation. J’ai poussé la chose très loin en imaginant une piñata – il s’agit, au moyen d’une batte de baseball, de casser un animal en terre cuite dans lequel se trouvent des confiseries et autres surprises. Celui qui frappe la piñata doit avoir les yeux bandés. Ici, le prêtre et le maire tiennent la corde de la piñata et la piñata est devenu un cheval. Richard, les yeux bandés par Buckingham, tient une croix en guise de batte de baseball. Et dans la piñata se trouve la couronne.
67Acte IV
68Plan de table 3.
69Les couverts en croix signalent qu’Anne a été envoyée à la mort. Les assiettes des deux enfants ont disparu. Les convives s’éloignent de Richard. Seuls restent près de lui Catesby et Buckingham.
70Scène 1.
71Ce sont les trois femmes qui essayent d’apercevoir les deux enfants enfermés dans la Tour. Ici, il y a encore une mutation de Richard qui devient la Tour de Londres. Il est désormais couronné. La Reine Elizabeth appelle ses deux enfants dont on ne distingue que les chapeaux, un chapeau de gnome pour le petit et un chapeau de bouffon pour le plus grand. Plus bas, on voit le corps de Clarence avec son fantôme qui commence à flotter – on se souvient que le prince avait peur de croiser le fantôme de son oncle. Richard l’avait rassuré! La Reine Elizabeth appelle ses deux enfants et son appel est symbolisé par la forme des deux chapeaux. L’un des pieds de Richard est représenté par la patte d’un sanglier.
72Scène 2.
73Cette scène m’est apparue comme une évidence. Buckingham, qui refuse d’assassiner les deux enfants prisonniers dans la Tour, se fait traiter de jacquemart par Richard. Je l’ai donc représenté en jacquemart tambourinant avec son marteau, non sur la cloche d’une horloge, mais sur la couronne. Ce jacquemart glisse sur le dos bossu de Richard. Richard a le regard agacé. C’est dans cette scène que Richard demande l’heure à Buckingham et que les dix coups vont bientôt sonner. Dans la couronne sont endormis les deux enfants, et l’on peut imaginer que ce jacquemart qui tente de les réveiller symbolise le remords de Buckingham.
74Scène 3.
75L’image parle d’elle-même. Ce sont les corps des deux enfants étouffés sous l’oreiller…
76C’est un spectacle de magie qui dévoile les talents de prestidigitateur des tyrans et hommes politiques. Il s’agit de la disparition d’Anne. La boîte s’est transformée en cercueil. Le prestidigitateur, c’est Richard qui nous fait croire qu’il va exécuter un tour de magie, mais il va vraiment utiliser sa scie. Dans la pièce, on ne sait pas trop comment elle disparaît.
77Scène 4.
78Cette scène fait allusion à une malédiction qu’avait proférée la vieille Reine Margaret et dans laquelle elle comparait Richard, le duc de Gloucester, à un chien qui peut mordre et mettait Buckingham en garde contre sa morsure. Margaret fait justement référence à ce chien dans cette scène: «Tu avais un Clarence et Richard l’a tué. / Du chenil de ton sein est sorti en rampant / Un chien d’enfer qui tous veut nous forcer à mort: / Ce chien poussa ses dents avant d’avoir des yeux / Pour mordre les agneaux, boire leur tendre sang». J’ai représenté «ce chien d’enfer».
79Cela renvoie à la première malédiction de Margaret (acte I, scène 3): «Ô Buckingham, prends garde à ce chien que voilà. / Lorsqu’il caresse, il mord et lorsqu’il mord, ses crocs / Sont venimeux et vont empoisonner à mort».
80Scène 5.
81Ce sont les dures paroles que la duchesse adresse à son fils Richard. J’ai imaginé une évolution de Richard, un peu comme l’évolution de l’homme de Darwin: on voit Richard depuis sa naissance jusqu’à l’âge adulte. À l’intérieur de son crâne pousse une sorte de molaire qui ressemble à une couronne.
82Sir Christopher est en prêtre. Il rend visite à Stanley. La confession se transforme en conspiration contre Richard. Stanley va trahir Richard. Le symbole de la croix représente le canal du passage d’information. Ici, la confession devient conspiration.
83Acte V
84Plan de table 4.
85Richard est désormais tout seul. C’est la solitude du tyran. Les restes du plat ont la forme de la carte d’Angleterre. Les motifs de la nappe basculent: une autre nappe avec motifs de roses rouges apparaît en dessous.
86Scène 1.
87Richard se débarrasse définitivement de Buckingham, ce que j’ai représenté en imaginant Richard allongé sur le ventre et exposant son dos à je ne sais quel chirurgien. Ce chirurgien lui arrache, à l’aide d’une grosse pince, une verrue représentant Buckingham, Buckingham qui a tant donné de sa cervelle pour mener Richard au pouvoir et sertir sa couronne.
88Scène 2.
89Richard est l’énorme sanglier. C’est Richmond qui le dépeint ainsi: «Le maudit sanglier, l’usurpateur sanglant / Pillant vos champs d’été et vos vignes fécondes, / Répand votre sang chaud comme eau sale, et son auge / C’est vos corps étripés». J’ai voulu montrer la société anthropophage et autophage de la tyrannie. On peut aussi y lire une allusion au mythe du Moloch, dieu représenté par une tête de bête, auquel on sacrifiait de jeunes gens. Dans l’histoire moderne, le Moloch est devenu un symbole de la tyrannie.
90En dessous se glisse la troupe de Richmond, semblable à des petites souris. Richmond s’apprête à ouvrir le ventre du sanglier pour libérer ceux qui ont été avalés. Leurs armes, des sortes de faux, ont la forme de la lettre L pour signifier Lancaster – on y voit aussi l’image de «la moisson de paix» selon l’expression de Richmond.
91Scène 3.
92Richard commence à estimer ses forces et demande à ses partisans d’estimer celles de Richmond. C’est comme un jeu de poker. Richard a une paire de neufs et plein de jetons qui forment une pile (la Tour) qui se nomme K I N G. Stanley est censé appuyer Richard. Quant à Richmond, il bluffe.
93Le tapis est un paysage-carte.
94Scène 4.
95Au poker, quand on a peur, on a le droit de jeter ses cartes et quitter le jeu. Stanley jette ses cartes. La conséquence, pour Richard, est annoncée métaphoriquement à la scène 6, et c’est ce que j’ai représenté à droite. C’est Richard qui dit: «Le soleil aujourd’hui ne va pas se montrer. / Le ciel est mécontent, menace notre armée». Il regarde l’almanach: ce sera une journée noire.
96Scène 5.
97C’est la scène la plus majestueuse de la pièce où apparaissent tous les fantômes, tous les remords de Richard. Ces fantômes viennent hanter le sommeil de Richard représenté de façon un peu comique, avec un bonnet de nuit, s’agitant sur sa couche. Au plafond de sa tente, les fantômes sont en fait des sacs mortuaires. C’est ainsi qu’on représentait les fantômes à l’époque élisabéthaine comme me l’a précisé Pierre Kapitaniak qui a fait une thèse sur les fantômes dans l’Angleterre élisabéthaine. On reconnaît chacun de ces fantômes. J’ai aussi repris le mythe de Damoclès: j’ai dessiné le postérieur d’un cheval dont les crins de la queue tiennent l’épée qui menace de tomber droit sur lui. Cette menace est renforcée par du sable qui s’échappe de certains sacs mortuaires et qui tombe sur l’épée, l’abîmant en même temps. Les fantômes souhaitent que l’épée de combat de Richard soit usée avant la bataille.
98Cette carte d’Angleterre figure l’allocution que Richmond fait à ses troupes. Comme il parle beaucoup de sang, on y voit une flaque de sang en forme d’Angleterre, une Angleterre recouverte de pièges à loups au milieu desquels se trouve la couronne d’Angleterre. Un cheval bondit par-dessus ce champ de pièges: c’est le cheval de Richmond qui essaie de le traverser. Cela montre aussi l’emprisonnement d’un peuple qui doit plier sous le joug de la tyrannie: dès qu’un sujet bouge, un piège s’ouvre. L’analogie graphique entre la couronne et le piège à loups signifie: «peuple pris au piège».
99Scène 6.
100J’ai remarqué une insistance sur l’armure. Richard réclame son armure. J’ai alors imaginé une armure pour un sanglier, en symbole de son discours très belliqueux vis-à-vis de l’ennemi, discours rempli de rancœur et de propagande. C’est aussi une planche reprenant les innombrables termes techniques de la guerre.
101Scène7.
102C’est une carte de bataille mouchetée de terre et de sang. Les cinq cartes sont posées: on découvre que Richmond a une suite royale et gagne la partie. Richard a perdu. Et la suite royale révèle le mariage entre la jeune Elizabeth et Richmond.
103Le cheval, c’est celui de Richard. C’est une image récurrente qui prédit sa malédiction.
104Il s’agit de la scène de bataille où Richard a cette phrase célèbre: «Un cheval! Un cheval! Mon royaume pour un cheval». J’ai repris cette phrase en imaginant que ce cheval devient le royaume d’Angleterre. Cela montre la folie du tyran qui entraîne tout son pays dans sa fin.
105Richmond en Saint Georges terrassant le dragon. Richmond, le futur Henry VII, «annonce la couleur» et sort l’Angleterre de cette noire période.
III. Notes complémentaires
De Richard II à Richard III
106Richard III m’a inspiré parce que cette pièce, comme Richard II mais un peu plus tard bien sûr, se passe à une époque que j’adore: cette époque charnière entre le Moyen Âge et la Renaissance. Richard II a été pour moi un travail plus personnel, plus sentimental, disons presque plus romantique, très axé sur le chagrin; j’y ai mis l’accent sur ce qui est de l’ordre de la vie privée. À mon sens, Richard II peut se lire comme un chagrin d’amour politique, avec un côté christique: le Roi y devient poète parce qu’il a perdu son royaume comme il aurait perdu une fiancée. Richard III, à l’inverse, est un travail plus ouvert sur le public, plus sur la vie sociale; il dit quelque chose de la conscience politique qui nous est commune. Richard II perd sa couronne; Richard III la gagne, mais le mécanisme infernal ne s’arrête pas pour autant.
Les références au tarot
107Je m’inspire souvent du tarot dans mon travail. Le tarot, en général, c’est l’outil de l’art divinatoire, du destin. Or, dans les pièces de Shakespeare, il est très souvent question de destins royaux. Pour ce qui est de Richard III en particulier, j’ai eu recours à la carte de la Tour et à la carte du Diable.
108Dans le jeu de tarot, cet arcane s’appelle La Maison Dieu: c’est une tour qui prend la foudre et où deux personnages tombent, en chute libre. J’ai transposé la Maison Dieu en Tour de Londres, et j’ai repris les personnages de l’arcane en figurant les deux princes enfermés dans la Tour. Au-dessus, c’est la main de Richard III qui agite la couronne.
109Quant à la carte du diable, elle s’est véritablement imposée à moi pour Richard III. Cet arcane représente la libido, le magnétisme sexuel, l’obscénité qui peut nous habiter et faire soudain surface. Sur l’arcane, Eve et Adam ont été diabolisés. J’ai, pour ma part, remplacé l’homme et la femme originels par les deux fils de la Reine Elizabeth, le duc d’York et le prince Edward. Le diable retire la couronne du crâne du futur Roi.
Richard III et le spectaculaire
110Richard III, c’est, selon moi, la pièce la plus spectaculaire de Shakespeare, si l’on excepte Titus Andronicus. Ce qui est spectaculaire me semble venir de l’arène. Il y a, dans l’imaginaire qui m’est propre, quelque chose de morbide dans l’idée du spectacle. Je m’explique en prenant un exemple. Dans La Tempête, je dirais qu’il s’agit plutôt de féérique que de spectaculaire. Pour moi, le spectaculaire, ça frappe par l’horreur, ça a quelque chose de monstrueux, ça appelle à l’esprit les foires où l’on montre des monstres sur des tréteaux, ce qui, à notre époque, se prolonge mutatis mutandis dans les boîtes à striptease où les corps se marchandent. Si Richard III fascine tant, c’est qu’elle agit comme un exorcisme de tout ce qu’il y a de plus sordide, de plus violent, de plus obscène dans notre société, dans la société que les hommes politiques façonnent. Richard III est justement l’allégorie d’un ensemble de déviances politiques poussées à leur paroxysme; il a un corps difforme qui, comme une éponge avide, absorbe, peut-être dans sa bosse, toute la noirceur de notre société et des crises qu’elle peut produire. Richard III, c’est un corps politique obscène qui se révèle au travers de jeux mesquins, imaginés pour la plupart par Buckingham. Richard III symbolise par ces jeux l’obscénité politique.
111J’ajouterai qu’il y a spectaculaire quand le regard est fasciné pour des raisons sombres. Et je suis moi-même entré dans la fascination du personnage et dans le mécanisme de la pièce, dans la mise en abyme des mascarades politiques de Richard et de Buckingham. Je ne peux m’empêcher de penser, en me représentant la pièce, à l’apparition d’une société du spectacle, une société autophage qui se nourrit de ses propres mensonges, de sa propre obscénité, et donc de son propre peuple (dans la pièce, la famille de York) qui est complètement aliéné.
112La danse macabre appartient pour moi à ce type de spectaculaire, c’est-à-dire le spectacle dans sa définition morbide. C’est à mon sens l’œuvre graphique la plus cynique et la plus fondamentale. Elle ramène tout à la mort, à la condition humaine, quelle que soit la classe sociale. D’où peut-être cette fascination pour Richard III, pas seulement la mienne, mais celle de l’ensemble des lecteurs, des spectateurs, et des metteurs en scène puisque c’est la pièce de Shakespeare qui continue d’être la plus jouée, alors que c’est celle qui met en scène l’action de la mort. On y voit la mort à l’œuvre dans toute son obscénité, alors qu’en général, on fait tout ce qu’on peut pour l’oblitérer, pour la reléguer dans les coulisses. Dans Titus Andronicus, il est davantage question de torture, d’ultra-violence, de mutilation, de cannibalisme; Shakespeare nous présente la vision insoutenable de la vie atrophiée. Dans Richard III, c’est la mort qui revient et qui grimace dans un parcours qui évoque une danse macabre.
RIII et la musique ou la Danse Macabre
113J’aimerais ajouter une dimension musicale à ce travail pictural, dimension musicale symbolisée par la partition en haut de la page de la danse macabre. Au départ, je voulais faire entendre de la musique de l’époque de Richard, c’est-à-dire de la musique médiévale comme celle de Guillaume Dufay, de Guillaume de Machaut. Mais j’ai finalement opté pour de la musique de notre temps, pour de la musique pop. En rapport à cette danse macabre, j’aimerais faire allusion à la chanson de Katerine qui dit «j’adooore regarder danser les gens». Cette chanson n’est pas forcément si gentillette qu’elle en a l’air. On peut l’entendre d’une façon plus ironique et plus cynique; on peut comprendre que les différentes classes sociales dansent dans cette société du spectacle et que, comme dans Richard III, on coupe le son et on le remet. J’aimerais inclure aussi de la musique moins contemporaine avec, par exemple, la scène du spectre de La Dame de pique, l’opéra de Tchaikovsky. J’aimerais mettre La Chevauchée des Walkiries de Wagner et, pour la fin de la tragédie, TheShow Must Go On de Queen, leThunderstruk d’ACDC. J’aimerais peut-être y ajouter une chanson de Kate Bush. Plusieurs extraits de musique viendraient animer cette danse macabre, tout en nous rapprochant de notre époque, comme pour nous dire: attention, ce qui se passe dans Richard III peut encore nous arriver.
Notes
1 Traduction de Jean Malaplate (William Shakespeare, Œuvres complètes (édition bilingue), Histoires II, Paris, Éditions Robert Laffont, 1997. Les traductions suivantes seront tirées de la même édition.