- Accueil
- > Shakespeare en devenir
- > N°2 — 2008
- > Éditorial
Éditorial
Par Pascale Drouet
Publication en ligne le 08 octobre 2007
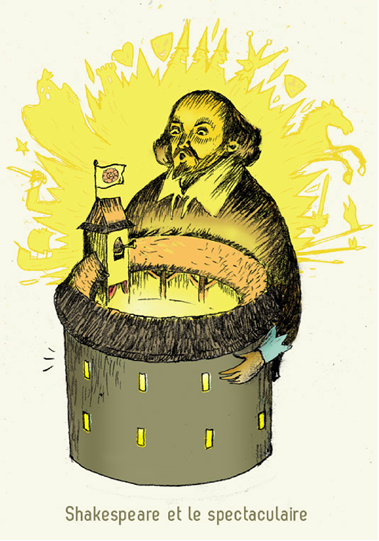
« Shakespeare et le spectaculaire » interprété par Édouard Lekston.
Crédits : Édouard Lekston.
Français
1Il s’agira de s’interroger sur l’économie du spectaculaire dans les pièces de Shakespeare et de ses contemporains, et sur le fait que le spectaculaire apparaît souvent au sein d’une mise en abyme comme pour en démultiplier les reflets et les effets cathartiques. On pourra se pencher sur un spectaculaire codifié, comme le « pageant », lié à une mise en scène officielle du pouvoir qui se doit de forcer l’admiration et le respect, ou comme le masque de court où le spectacle époustouflant côtoie la surenchère, tout autant qu’un spectaculaire plus évanescent, plus irrationnel, celui des apparitions spectrales (Hamlet, Macbeth) et des mises en scène surnaturelles (The Tempest), destiné d’emblée à frapper de stupeur, sans oublier le théâtre de la cruauté (Titus Andronicus, King Lear), version fictive du supplice et de sa visibilité sur la place publique, et dont la dimension spectaculaire peut rapidement, sur scène, basculer dans le grand-guignolesque. On s’intéressera donc au rapport, explicite ou implicite, entre spectaculaire et idéologie, entre spectaculaire et pouvoir (en amont et en aval : qui tire les ficelles et pour obtenir quels résultats), entre un spectaculaire qui serait du pur divertissement et un spectaculaire qui serait l’affirmation inconditionnelle d’un pouvoir absolu — autrement dit, existe-t-il une économie politique du spectaculaire ? le spectaculaire peut-il être l’expression médiatisée d’une instance totalitaire ?
2Ces interrogations trouvent de nouveaux prolongements lorsqu’il s’agit de représenter, que ce soit à la scène ou à l’écran, le spectaculaire. Certes Shakespeare choisit (et il sera intéressant de se demander pourquoi) de rapporter, en recourant au discours épidéictique ou à l’ekphrasis, certaines scènes grandioses (la victoire de Coriolan, l’arrivée de la nef de Cléopâtre) ou si riches en émotions qu’elles en deviennent presque inexprimables (les retrouvailles de Léontes et de sa fille). Mais certains metteurs en scène et réalisateurs ne se sont-ils pas risqués à représenter ces moments d’intensité ? dans quelle mesure y sont-ils parvenus ? Plus généralement, comment le spectaculaire se met-il en scène ? De quels moyens le théâtre et le septième art disposent-ils ? Quels problèmes cela pose-t-il ? Ce qui en impose à l’imagination ne risque-t-il pas de perdre en intensité en tentant de parler aux yeux ? On pourra étudier comment, selon les siècles et les cultures, les metteurs en scène, puis les cinéastes, ont traité la question du spectaculaire, et comment ils s’y prennent de nos jours pour éveiller les émotions et provoquer les réactions de spectateurs vivant dans une société saturée d’effets spéciaux et d’images-chocs.
English
3Is there an economy of the spectacular in Shakespeare’s plays—or those of his contemporaries? Is the spectacular always caught in a pattern of mise en abyme? How does it reverberate, cathartically or not, from the actor-spectator to the spectator? Several types of spectaculars could be considered. One spectacular, that of pageants for example, codified and controlled by official power and whose aim is to impose admiration and respect, or that of court masques presenting an amazingly costly show. A more evanescent spectacular flirting with the irrational and corresponding to ghostly apparitions (Hamlet, Macbeth) and supernatural phenomena (The Tempest) which is intended to leave spectators dumbfounded. Another type of spectacular falls within the scope of the theatre of cruelty (Titus Andronicus, King Lear) and can be regarded as a fictitious version of highly visible public tortures—running the risk of appearing over-gruesome on stage. So, what may be given focus to is no doubt the articulation between the spectacular and ideology, between the spectacular and power (who pulls the strings and what for), between sheer entertainment and wonder and a show unquestionably designed to assert absolute power—to rephrase it, is there a political economy of the spectacular? Could the spectacular be the mediated expression of some absolutist force? What else could it be?
4Such questions are given further scope when the spectacular is to be performed on stage or adapted on screen. Many are the times when Shakespeare, resorting to epidictic discourse or ekphrasis, has characters reporting spectacular scenes (Coriolanus’s military feat for example, or the arrival of Cleopatra’s barge), sometimes so deeply emotional that they can hardly be reported (the reunion of Leontes and Perditafor instance). Some stage or film directors have nevertheless attempted to show those intense moments. To which point were they successful? More generally speaking, how can the spectacular be performed and with what technical means? Is the screen always more powerful than the stage? Isn’t there the risk of a loss in intensity when what strikes the imagination is explicitly put before our eyes? Performing the spectacular has evolved through ages and cultures, and the practice may closely follow technological improvements. But nowadays how do directors, both stage and film, manage to trigger the emotions and reactions of spectators living in a society saturated with special effects and shock pictures?
Bibliographie
Quelques pistes bibliographiques :
AEBISCHER, Pascale, Shakespeare’s Violated Bodies: Stage and Screen Performance, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.
ALEXANDRESCU, Sorin, « Spectacle et spectaculaire », Kodikas/Code/Ars semeiotica, vol. 7, n°1-2, Winter 1984, p. 47-62.
ALEXANDRESCU, Sorin, « L’Observateur et le discours spectaculaire », in Herman Parret & Hans-George Ruprecht (eds.), Exigences et perspectives de la sémiotique : Recueil d’hommages pour Algirdas Julien Greimas, Amsterdam, Benjamins, 1985, p. 553-574.
BACKSCHEIDER, Paula R., Spectacular Politics: Theatrical Power and Mass Culture in Early Modern England, Baltimore, John Hopkins University Press, 1993.
BERGERON, David M. (ed.), Pageantry in the Shakespearean Theater, Athens, University of Georgia Press, 1985.
BEVINGTON, David, This Wide and Universal Theater: Shakespeare in Performance Then and Now, Chicago, University of Chicago Press, 2007.
CRUNELLE-VANRIGH, Anny, “Henry V as a Royal Entry”, SEL, vol. 47, n°2, Spring 2007, p. 355-377.
DANCHIN, Pierre, « Le Développement du spectaculaire sur le théâtre anglais (1660-1800) : le rôle des prologues et des épilogues », Medieval English Theatre, vol. 16, 1994, p. 166-176.
JACKSON, Russel, “Actor-Managers and the Spectacular”, in Jonathan Bate & Russel Jackson (eds.), Shakespeare: An Illustrated Stage History, Oxford, Oxford University Press, 1996, p. 112-127.
LASCOMBES, André, « Pour une rhétorique du spectaculaire : Notes sur l’ostention », Medieval English Theatre, vol. 16, 1994, p. 10-24.
LEHMANN, Courtney & STARKS, Lisa (eds.), Spectacular Shakespeare: Critical Theory and Popular Cinema, London, Associated University Press, 2002.
NEWCOMB, Lori Humphrey, “‘If That Which Is Lost Be Not Found’: Monumental Bodies, Spectacular Bodies in The Winter’s Tale”, in Goran Stanivukovic & Valerie Traub, Ovid and the Renaissance Body, Toronto, University of Toronto Press, 2001, p. 239-259.
PALMER, Barbara D., “Shakespearean Openings with a Flourish: Pageantry as Introduction”, in Robert F. Willson (ed.), Entering the Maze: Shakespeare’s Art of Beginning, New York, Peter Lang, 1995, p. 27-36.
PAVIS, Patrice, « Production et réception au théâtre : la concrétisation du texte dramatique et spectaculaire », Revue des Sciences Humaines, vo. 1, n°189, 1983, p. 51-88.
RHOME, Frances Dodson, “From the street to the stage: Pageantry in the History Plays”, The Upstart Crow, vol. 5, Fall 1984, p. 64-74.
SCHOCH, Richard W., “(Im)pressing Texts & Spectacular Performance: The Quarrel between Ben Jonson and Inigo Jones”, Constructions, vol. 9, 1994, p. 1-12.
SMITH, Bruce R., “Perspectives on Shakespeare’s Pageants-within-the-Play”, Renaissance Papers, 1982, p. 51-63.
SPIELMANN, Guy (ed.), « Spectacle et Spectaculaire à l’Age Classique » / “Spectacle and the Spectacular in the Classical Age”, Esprit Créateur, vol. 39, n°3, Fall 1999.
VILQUIN, Jean-Pierre, « Attraits et outrances du spectaculaire sur la scène jacobéenne : The Travailes of the Three English Brothers, Sir Thomas, Sir Anthony, Mr Robert Shirley (1607) », Medieval English Theatre, vol. 16, 1994, p. 126-141.
VILQUIN, Jean-Pierre, « Spectacle et spectaculaire dans Hamlet », QWERTY : Arts, Litératures et Civilisation du Monde Anglophone, vol. 6, Fall 1996, p. 87-95.