- Accueil
- > Shakespeare en devenir
- > N°5 — 2011
- > Éditorial
Éditorial
Par Nathalie Rivère de Carles et Pascale Drouet
Publication en ligne le 14 décembre 2024
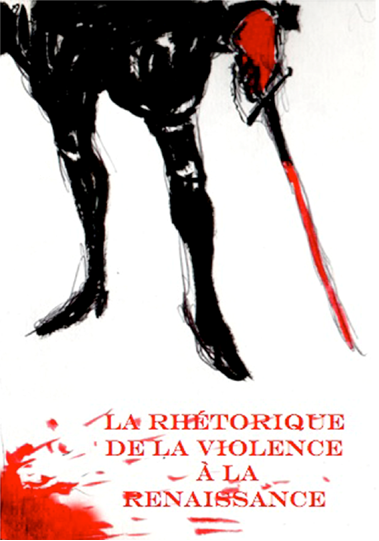
« Rhétorique de la violence » interprété par Édouard Lekston.
Crédits : Édouard Lekston.
Français
1Comment la violence s’exprime-t-elle dans la littérature et les arts de la Renaissance, et dans leurs adaptations et réappropriations postérieures ? Comment fait-on de la violence un outil d’intimidation, un instrument de persuasion ? Comment fait-on sentir sa puissance déterritorialisante, voire traumatisante ? Quelle en est la rhétorique littérale et métaphorique ? Ces questions peuvent se poser dans une perspective mono-disciplinaire et interdisciplinaire. Le croisement des genres et des modes d’expressions artistiques est une voie qu’il est nécessaire de confronter au traitement de la violence à l’intérieur d’un seul et même champ historique, philosophique, littéraire ou philologique. L’exploration du cadre théorique et langagier d’une poétique de la violence semble fondamentale pour aborder les questions d’esthétique et d’interprétation de la douleur reçue et infligée.
2« I will speak daggers to her, but use none1 »
3Cela pose la question du rapport entre violence et langage : à partir de quel seuil le discours produit-il une violence (et de quel type) sur son interlocuteur ? On pourra penser à l’injure, à la malédiction, à l’abus de la forme performative, mais aussi à la torture (le forcer-à-dire) et à la censure (le forcer-à-taire) qui peuvent déboucher sur des violences physiques. On pourra s’attacher aux manières d’exprimer cette violence et de dire comment elle est ressentie, à ses modes rhétoriques et génériques : à quel type de métaphores recourt-on (cannibalisme, images contre-nature, métaphores martiales, emprunts aux théâtres d’anatomie), quels genres (pamphlet politique, satire, tragédie de vengeance, tragédie domestique, tragédie de casibus) en procurent le cadre ?
4Cela pose aussi la question de la frontière entre violence physique et violence psychique, et de la représentation de la violence faite à l’intériorité, de la réception de la violence par l’intime. Si on sait représenter le corps souffrant (corps de suppliciés, étude de la torture, anatomie punitive, martyrologie), comment donne-t-on à voir le martyr psychique ? Le traitement des corps des condamnés, la symbolique du corps déformés par la douleur et de l’âme meurtrie par la violence psychique ouvrent la voie de réflexions sur l’impact sociétal, scientifique et philosophie d’un corps et d’une intériorité violentés.
5Autrement dit, comment et surtout pourquoi représente-t-on la violence ? Quels en sont les enjeux visuels et esthétiques, quels en sont les enjeux politiques ? On connaît, depuis Foucault, la nécessité de rendre le supplice publique, de rendre tout châtiment visible et lisible, de « faire éclater en plein jour le rapport de force qui donne son plein pouvoir à la loi2 ». La représentation de la violence est-elle indissociable des notions de pouvoir, d’exhibition et de théâtralisation, d’exorcisme et d’instrumentalisation ? Peut-on aussi s’intéresser à la rhétorique de la violence pour témoigner et peut-être dénoncer, aller à son encontre ? Quels sont alors les risques encourus ? Peut-on remettre en cause les pratiques violentes d’une société sans encourir d’effets talion ?
6Au théâtre, comment met-on en scène les actes de toute cruauté ? On pense d’emblée aux scènes clefs de Titus Andronicus et de King Lear. Comment les metteurs en scène trouvent-ils la juste mesure entre « théâtre de la cruauté » et grand-guignol ? Comment recrée-t-on un spectacle de l’effroi ? Où place-t-on la limite du supportable pour le spectateur ? Comment les rhétoriques dramaturgiques et linguistiques de la violence s’articulent-elles ? Quel impact le visuel ajoute-t-il ? On pourra aussi se demander ce qu’apportent à ce questionnement les adaptations cinématographiques contemporaines des pièces jacobéennes ?
7Les abstracts (300-500 mots) sont à envoyer à Pascale Drouet et Nathalie Rivère de Carles avant le 30 November 2010. Les articles (une fois l’abstract accepté) devront être envoyés, accompagnés d’une brève bio-biblio rédigée, d’une bibliographie, et d’un abstract en anglais, pour le 30 April 2011. Merci de suivre les consignes de la feuille de style des Cahiers Shakespeare en devenir (en ligne).
English
8We invite submissions for the 2011 issue of Cahiers Shakespeare en devenir / Shakespearean Afterlives. These might include essays (6000-7000 words including notes) for the issue proper, and review-essays (2-3000 words) or reviews of plays or exhibitions (1000-1500 words) for the issue’s supplement L’Oeil du spectateur.
9The 2011 issue of the journal is dedicated to interdisciplinary and monodisciplinary approaches to the theme of violence against body and soul in literature and the arts, from the Renaissance to the Long Eighteenth Century. Focusing on the theme of the tormented body, this issue will offer a different insight into verbal and visual representations of violence in both theoretical and practical terms. It will concentrate on the analysis of how violence was presented to the early modern public and on the iconoclastic consequences of both violence and its representations: “Of course violence at once shocked and repelled people by its brutality. But it also fascinated many because it so contradicted religious precepts and social norms” (Ruff, 2001: 28). Violence needs to be considered as a means of constraint, and as a form of political and aesthetic subversion and resistance to the excessive forms of regulation of which it was the instrument.
10We will consider papers on Shakespeare and/or his contemporaries (literature and performance studies), on early modern literature and the arts in England, Europe, The East and the New World, on the paragon of violence in Early Modern works of art, and on the representations of Renaissance violence and violent topics in subsequent eras.
11Targeted disciplines: English Literature, Comparative Literature, Theatre studies, Performance studies, Cinema studies, History of Ideas, History of Arts, Philology.
12Topics might include (non-exclusive list):
-
The aesthetic views and interpretations of pain in literature and / or the arts
-
Martyrology and its avatars: the representations of martyrdom in literature and visual arts, the politics of martyrdom
-
The suffering body: the symbolic of wounds, scars socially, theologically and aesthetically
-
Anatomy: scientific and aesthetic implications, the evolution of the representation of the anatomized body
-
Exorcism and catharsis: violence as punishment and purification
-
Torture: political, theological, and aesthetic impacts and representations
-
The treatment and the use of violent mythological and biblical episodes in political and literary writings and in visual arts
-
The poetics of violence: the language of violence in pamphlet literature, satirical writings, revenge plays
-
Violence in dramatic genres: the redefinition of dramatic genres through violence
-
The representation of violent episodes in Shakespearean texts in 18th and 19th century paintings
-
The use of violence in stage productions and / or film adaptations of early modern plays
-
Reviews of plays, of exhibitions related to the topic
13Cahiers Shakespeare en devenir- Shakespearean Afterlives is a peer-reviewed journal (part of Les Cahiers de la Licorne) aiming at promoting the current international scholarship on the Early Modern period and its reverberations throughout the centuries. Its purpose is to offer both a disciplinary and an interdisciplinary approach to the study of Shakespeare and his contemporaries and to see Renaissance drama in its contemporary and subsequent geographical and aesthetic contexts.
14Please visit our website: URL.
15Please send abstracts between 300 and 500 words to the editors: Pascale Drouet and Nathalie Rivere de Carles by 30th November 2010. Notifications of acceptance will be sent by 15th December 2010 and completed essays or reviews (with a short note on contributor and bibliography) will be due by 30th April 2011. Please take into account the online stylesheet for the Cahiers Shakespeare en devenir.
Notes
1 William Shakespeare, Hamlet, ed. G. R. Hibbard, Oxford, Oxford University Press, coll. « World’s Classics », III.2.379.
2 Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1975, p. 61.
Pour citer ce document
Quelques mots à propos de : Nathalie Rivère de Carles
Quelques mots à propos de : Pascale Drouet
Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)